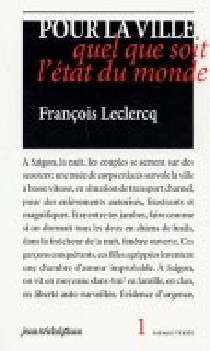LECLERCQ, François (2006) : Pour la ville, quel que soit l’état du monde, Editions NEJMP, Collections Passage Vérité
|
PRÉLIMINAIRES
La ville est faite de lumières, elle représente le rêve américain, l’avenir, l’espoir d’un devenir. La ville permettait de prendre en main son propre avenir et surtout d’en décider, il ne s’agissait plus de perpétuer un cycle familial auquel on ne pouvait échapper. Les trente glorieuses a permis aux rêves de devenir réalité. La croissance économique et le pleine emploi a permis la modernité et l’indépendance, l’individualisme et la mobilité.
Mais l’urbanisme de ces trente glorieuses se fait rapidement mauvaise figure, les crises urbaines apparaissent, les grands ensembles deviennent l’endroit où se croisent malheur et sans espoir, la ville devient un espace de peur et sans horizon : chômage de masse, situation de rupture, déconnexion des bassins d’emploi et de l’habitat.
Face à la pression sociale, les politiciens ont pointé une génération « de culture de la violence » liée au quartier de ces grands ensembles. Ces bâtiments sont devenus responsables de ce mal être. Il fallait rénover ces quartiers, ces cités, les normaliser, les rendre éligibles au bonheur, prendre ce qui fonctionnait et reconnaissait en mieux. Ce désespoir social ne peut être que passager, l’homme a façonné ses villes d’opportunité, elle ne peut pas être autrement. Mais les problèmes ont fait que s’étaler entraînant un peu plus la ville dans la crise, car il s’agissait bien d’une crise de la ville et non des quartiers. En pointant les problèmes uniquement aux cités, la crise a continué son chemin dans les villes entraînant « rupture, éloignement, et dépendance ».
En 2006, le constat est que l’on construit toujours la ville à l’identique de l’après guerre, croissance, rentabilité, pleine emploi. L’urbanisme continue de concevoir comme si la crise était passagère, elle s’accroche à un rêve perdu, à une nostalgie d’un bonheur à retrouver. Mais si finalement c’était les trente glorieuses que l’on considérait comme la crise, si la réalité était le sous emploi et que la société acceptait que la croissance favorisait la stagnation, la précarité et l’inégalité et donc toutes sortes de ruptures, est-ce que l’on construirait la ville de la même façon ? Dans une société où il faut allé vite autant pour se déplacer que pour se dépasser, est ce que l’on ne finit pas par se battre contre des moulins à vent.
Et si le pari n’était pas la ville pauvre, celle au tout le monde peut être pris en compte, une ville moins rapide mais avec plus de linéarité. Une ville où l’homme se satisfait pour son utilité et non pas pour son profit. La ville doit être une ville de toutes les ressources afin que chacun puisse trouver sa place dans n’importe quelle circonstance et dans chaque évolution de la vie.
François LECLERCQ étaye ses préliminaires à travers 5 exemples.
1- Tout d’abord “ROSETTA fait ses études“, cet exemple montre l’évolution de l’occupation des immeubles dans sa verticalité et notamment du rapport que pouvait entretenir un immeuble avec la rue, avec son sol. En effet, le cas de ROSETTA montre la difficulté pour les jeunes étudiants de se loger et inévitablement de finir soit dans des résidences pour étudiants où le prix est de plus en plus exorbitant où bien loger dans des caravanes dans des conditions très précaires mais avec des loyers peu coûteux, ce qui le cas de ROSETTA.
On constate que l’immeuble du XIX se décomposait dans se verticalité en fonction des classes sociales, chaque étage correspondait à ses ressources mais tout le monde vivait ensemble et trouvé sa place en attendant de gagner plus d’argent et de changer d’étage. La modernisation comme l’ascenseur a permis de gravir les étages en modifiant ces couches sociales verticales, en créant des regroupements sociaux mais à l’horizontale ce qui à conduit à créer des quartiers aux fonctions bien spécifiques.
L’étage le plus touché par cette modification est le rez de chaussée, il n’y a plus de concierge et ce niveau n’apporte pas les qualités requises pour la société d’aujourd’hui, trop bruyant, pas assez intimes, et peu de lumières. Aujourd’hui les personnes préfèrent monter alors que ces étages étaient réservés aux étudiants et aux classes sociales inférieures. Le rez de chaussée est déserté pour faute de rentabilité économique et pourtant il représente plus de 10% de l’occupation en ville. Si les gens ne souhaite pas le rez de chaussée dans sa valeur définitive rendant dont le transitoire. Créons des logements étudiants, qui pourront prendre la fonction de bureaux associatifs. Permettons à chacun de trouver une place dans des conditions acceptables, trouvons des solutions modulables pour permettre l’évolution de ces rez de chaussée tout en recréant une véritable mixité.
2- Le chapitre « les dames des échangeurs » montrent l’intérêt pour le commerce de proximité. Ces femmes aujourd’hui sans permis font des détours invraisemblables pour arriver jusqu’à leur hypermarché. Ces magasins de grandes distributions ont radicalement changé l’urbanisme des années 60 entraînant la création des zones industrielles, des zones pavillonnaires et des zones d’emplois. Les petits commerçants meurent un peu plus chaque jour éloignant les personnes avec leur cœur de ville. Mais aujourd’hui l’hyper arrive a ses limites, et à du mal a se renouveler, les slogans publicitaires changent et favorisent la proximité et la flexibilité. Le modèle du magasin change et se réinvente, la tendance est au « small is beautiful ». Il faut saisir l’opportunité de ce changement pour le banaliser et offrir des commerces à toutes les populations.
3- Comme, François LECLERCQ a pu le citer dans le chapitre précédent, le zoning des années 60 a entraînant la création de zones pavillonnaires. Le droit au bonheur se démocratise par une maison individuelle pour tous. En soi, le rêve est beau mais il devient plus complexe quand le pavillon devient un produit de marchandise, et qu’il est associé à plusieurs pavillons formant ainsi un lotissement synonyme d’éloignement. Alors on n’achète plus un pavillon mais un mode de vie régit par les règles du lotissement. Cela créer des personnes indépendantes et donc consommatrices. De plus ces lotissements sont éloignées des villages et des villes et leur forme n’est dictée ni par l’histoire, ni par les demandes des habitants, ces lieux sont complètement standardisés du nord au sud et ne répondent à rien. Ils favorisent le déplacement en voiture sans qui la solitude et la dépendance s’installe. Cela se vérifie quand les familles se décomposent, quand les revenues manquent où que les personnes vieillissent, la distance et l’éloignement se font encore plus grands. Ce mal être n’est pas loin de celui connu pour les grands ensembles. Au lieu d’avoir des drames collectifs, il y a des drames individuels. Il faut sortir du lotissement et apprendre à réconcilier la maison individuelle avec la proximité des gens, des services, et du transport, en la remmenant prêt des villages.
4- François LECLERCQ met l’accès aussi sur la définition d’une ville durable. Elle se veut « ville intermédiaire, ville passagère, ville qui voyage dans ses propres murs ». C’est à dire qu’il s’agit plutôt d’accepter qu’une ville évolue avec son temps et qu’elle puisse prendre plusieurs formes dans la journée mais surtout plusieurs usages dans les années. Il ne s’agit plus de créer dans des bâtiments intemporels souvent désastreux mais que l’architecture s’approprie et conçoit un bâtiment pour des temps.
5- Mais dans tout cela, il ne faut pas voir tout ce qui a été bâti durant ces trente glorieuses comme le mal à bannir entièrement de la planète. François LECLERCQ prend pour exemple la voiture, objet détestable du XXI siècle, mais qui à SAIGON est considéré comme lieu. Là où la densité est très présente et l’intimité rare, la voiture est un moyen de se retrouver seul ou à deux, de se sentir libre : libre de chanter, de parler, de rêver, de s’évader, de faire l’amour…
A travers ces exemples, François LECLERCQ tente de nous faire comprendre qu’il faut savoir saisir les opportunités de changement quand elles sont nécessaires en fonction de l’évolution des besoins. Il est inutile, voir perdu, de vouloir contrôler le changement afin que le bonheur soit parfait, que c’est en cela que les catastrophes sont de plus en plus fréquentes entraînant des malaises sociales. Il ne s’agit plus de raisonner individuellement mais rendre la ville à portée de tous.
DEPERROIS A.
LECLERCQ, François (2006) : Pour la ville, quel que soit l’état du monde, Editions NEJMP, Collections Passage Vérité. LE GUAY, Philippe (2011) : Les femmes du 6e étage, film, 106′. ABRIL, Philippe (2009) : Lotissement, Huile sur toile, 60 40 cm.
|